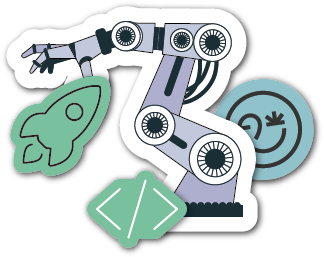Julia Meyer, ingénieure numérique responsable à l’ADEME, alerte sur l’empreinte croissante de l’intelligence artificielle, en particulier de l’IA générative. Si son usage se banalise dans les organisations, ses coûts environnementaux restent difficiles à mesurer, faute de transparence des acteurs et de données spécifiques aux usages professionnels.
Elle plaide pour une évaluation rigoureuse de la pertinence de ces outils avant son adoption par les acteurs économiques.
Vous comptez parmi les expertes qui évaluent l’impact environnemental du numérique. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre rôle ?
Je travaille au sein du service sobriété numérique, qui compte quatorze personnes. Mon rôle est centré sur l’évaluation : je pilote des études que nous lançons pour mieux comprendre les impacts environnementaux du numérique en général, let j’assure le développement de méthodes pour mieux quantifier ces impacts, y compris l’intelligence artificielle.
Dispose-t-on de chiffres précis sur le coût énergétique de l’IA au travail ?
Non, pas vraiment. C’est difficile de dissocier les usages professionnels et personnels, d’autant que les mêmes outils – ChatGPT, Copilot, Gemini…– sont utilisés dans les deux contextes. On n’a donc pas d’estimation spécifique pour l’IA au travail. En revanche, on sait que l’IA générative pèse de plus en plus sur la consommation énergétique mondiale. L’Agence internationale de l’énergie estime que la consommation électrique des data centers pourrait doubler d’ici 2030, atteignant l’équivalent de celle du Japon, et que 70 % de cette hausse serait imputable à l’intelligence artificielle.
Pourquoi est-ce si difficile d’obtenir des données fiables ?
Parce que les acteurs qui développent ces outils manquent de transparence. Des études sont sorties récemment sur l’impact environnemental de type LLM, avec plus ou moins de transparence sur les hypothèses et le périmètre étudiés. Cela rend très difficile la comparaison entre les outils, bien que certains acteurs utilisent ces différentes sources pour se revendiquer moins impactant. Globalement, il y a un vrai problème de transparence.
Quel est l’impact du déploiement d’infrastructures spécifiques à l’IA ?
Il est très significatif. Pour faire tourner ces modèles, les data centers installent massivement des GPU - des cartes graphiques puissantes qui consomment environ 700 watts chacune – l’équivalent d’un four à micro-ondes. Certaines entreprises, comme Meta, évoquent des infrastructures de plus de 600 000 GPU. Cela explique la hausse de la consommation électrique des data centers.
Existe-t-il aujourd’hui un encadrement réglementaire de ces impacts ?
Pas vraiment. En France, consécutivement au sommet mondial sur l’IA de janvier 2025, on encourage l’installation de data centers dédiés à l’IA, en mettant en avant notre mix énergétique décarboné. Mais les usages réels de ces infrastructures échappent à toute transparence. L’IA Act, adopté au niveau européen, vise surtout la gestion des données personnelles et la sécurité. Le volet environnemental est faible. Des initiatives intéressantes existent cependant, comme le référentiel d’« IA frugale » publié par l’AFNOR, mais elles reposent sur le volontariat, sans contrainte.
Et sur la consommation d’eau des data centers ?
C’est un autre sujet majeur. Une étude prospective est en cours à l’ADEME, menée par le service bâtiment, pour estimer les impacts environnementaux des data centers en France d’ici à 2030 et 2050, incluant leur consommation d’eau. À ce stade, il faut rappeler que les techniques les plus consommatrices, comme le refroidissement par pulvérisation d’eau, concernent surtout les très grands data centers aux États-Unis. En France, les sites sont plus petits et utilisent des procédés moins gourmands.
Quel message adressez-vous aux organisations qui veulent adopter l’IA dans leur stratégie ?
La première question à se poser est : a-t-on vraiment besoin d’IA générative ? Et si oui, quelles limites se donne-t-on ? Son usage est souvent banalisé, mais il faut l’évaluer avant de l’autoriser, en tenant compte des impacts environnementaux et des enjeux de confidentialité des données transmises aux outils, qui peuvent être réutilisées. Des outils existent, comme Ecologiit, pour estimer l’empreinte carbone des projets numériques. Et il ne faut pas oublier que les gains de productivité promis peuvent être annulés si l’on passe beaucoup de temps à vérifier la fiabilité des résultats.
Propos recueillis par Valérie Ravinet
Pour aller plus loin :
|
ITW tech & inno
Les interviews d’experts et d’expertes qui permettent de comprendre comment l’intelligence artificielle et l’innovation transforment le monde du travail. Dialogue social, droit, formation, égalité femmes-hommes, santé mentale, métiers : chaque entretien éclaire un enjeu clé des révolutions technologiques.