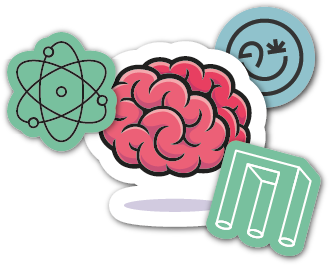Bonne nouvelle, nous avons tous des « zones de talent », qu’elles soient professionnelles ou personnelles. Ces aptitudes à faire naturellement ce que d’autres trouvent ardu, peuvent être innées ou acquises par l’expérience. Nous pouvons tous ressentir cette facilité à faire dans certains domaines, alors que d’autres peinent. Quoi que séduisant, ce concept n’existe pas du point de vue des sciences du cerveau. En revanche, les neurosciences ont apporté le concept révolutionnaire de neuroplasticité : car, oui, le cerveau peut se reconfigurer tout au long de la vie. Dans la mesure où l’on s’en sert pour développer ses … talents.
La "zone de talent" n'existe pas selon les sciences
Le concept de « zone de talent » (ou « zone de génie ») a été développé par Gay Hendricks. Selon ses recherches, dans cette zone, nous disposons d’aptitudes qui nous prédisposent à agir avec peu d’effort, avec fluidité (on comprend vite et on exécute facilement), avec énergie (on se sent stimulé, pas fatigué), avec satisfaction (liée à la facilité), et avec des résultats supérieurs à la moyenne (sans forcer).
Pourtant ce concept de zone de talent n'a aucune validité du point de vue des neurosciences. L'approche des neurosciences cognitives et comportementales préfère parler de prédispositions et de zones d’efficacité naturelle (Z.E.N.). En effet, ces domaines, bien que favorisant l'expérience de flow, sont définis de manière plus scientifique. La Z.E.N. est basée sur l'hypothèse de l’efficience neuronale : à performance égale, certaines personnes ou certains cerveaux consomment moins de ressources ou requiert un effort mental plus faible pour certaines familles de tâches. C'est là où le cerveau consomme moins d'énergie cognitive que l'individu perçoit l'activité comme « naturelle ».
Pourtant notre ressenti atteste qu’elle existe...
Malgré l'absence d'une appellation formelle, les neurosciences expliquent pourquoi certaines activités sont vécues avec plus d'aisance et de plaisir, correspondant à cette "zone de talent".
La zone d'efficacité naturelle apparaît à l’intersection de trois éléments clés. D’abord les prédispositions cognitives, chacun de nous disposant de formes d’attention, de mémoire et de perception qui sont optimisées pour certains types de tâches. Ces aptitudes sont natives ou acquises. Ensuite les motivations intrinsèques. Ancrées profondément dans notre cerveau, elles déclenchent le système de récompense (dopamine) du cerveau, rendant l'effort acceptable voire agréable. C'est ce qui donne du sens ou un plaisir inconditionnel à l'effort. Et enfin, les expériences répétées, la pratique délibérée façonnant l'architecture cérébrale et fluidifiant notre capacité à agir.
... Et nous pouvons en développer tout au long de la vie !
L'une des découvertes majeures des neurosciences qui nuance tout déterminisme est la neuroplasticité, cette capacité du cerveau à se remodeler en créant de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie. Les raisons ? L'entraînement, qui façonne le cerveau; d’ailleurs des études démontrent que l'apprentissage modifie la structure cérébrale. Par exemple, les chauffeurs de taxi londoniens, après un entraînement intensif, ont accru la capacité de leur cerveau qui gère l’orientation dans l’espace. Autre explication, le développement de nouvelles compétences. En effet, explorer de nouvelles méthodes de travail tout au long de sa vie professionnelle permet de reconfigurer sans limite son cerveau. Et puis l’interaction entre inné et acquis. L’expérience s’appuie certes sur l’acquis, mais la remettre en cause est essentiel pour s’adapter et la développer.
Mettre à profit sa Z.E.N au travail
La connaissance de cette zone d'efficacité naturelle est essentielle pour la performance durable au sein des organisations. Travailler dans sa Z.E.N. favorise la confiance, la créativité, la résilience et une performance stable. À l'inverse, travailler loin d’elle génère de la fatigue, du stress et de la démotivation. Par ailleurs, nourrir ses motivations intrinsèques (le plaisir inconditionnel de faire l'activité) est plus efficace et plus durable que de se fier aux récompenses extérieures (motivations extrinsèques). Le plaisir découlant de la tâche elle-même ne peut être surpassé par des systèmes de récompense artificiels. Et puis, la connaissance de la façon dont le cerveau fonctionne (efficience, biais cognitifs) permet aux managers d'adopter une posture "neuro compatible". Cela implique de s'intéresser au collaborateur en tant qu'humain, et non seulement à la tâche.
Les neurosciences appliquées fournissent ainsi un nouvel éclairage, aussi bien aux manageurs qu’aux collaborateurs. Elles permettant de renforcer des compétences clés, notamment l'intelligence émotionnelle, la prise de décision et la gestion du changement. Elles aident également à identifier les activités dans lesquelles nous pourrons au mieux exprimer nos zones d’efficacité naturelle.
Dans nos cerveaux
La chronique explore les méandres de l'esprit humain à travers le prisme des sciences cognitives et comportementales. Celles-ci nous permettent de comprendre la complexité de nos comportements et des processus cognitifs qui les sous-tendent. Mémoire, fonctionnement psychologique et organisationnel, charge mentale ou charge émotionnelle… la science a son mot à dire.