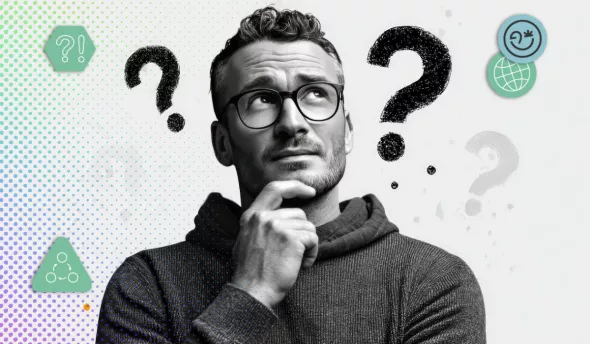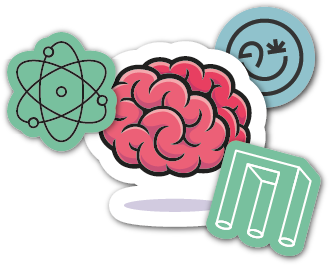On a longtemps parlé d’un monde VICA/VUCA : volatile, incertain, complexe et ambigu. Aujourd’hui, un autre acronyme s’impose : FANI – fragile, anxiogène, non-linéaire, incompréhensible. Derrière ces jeux de lettres, une même réalité : nous vivons dans un environnement de changement permanent. Les chocs économiques qui se succèdent et les accélérations technologiques installent une incertitude durable. Il faut désormais décider et agir avec très peu de visibilité, dans un contexte en perpétuel mouvement, alors même que notre cerveau, lui, recherche avant tout stabilité et sécurité.
Alors comment faire face pour éviter que l'imprévu ne nous paralyse, et comment transformer l'anxiété en énergie créatrice ?
Un monde incertain, source de stress
La mondialisation des marchés a rendu les économies nationales interdépendantes, et plus sensibles aux aléas. Les tensions géopolitiques, les crises énergétiques et sanitaires ont fragilisé les activités des entreprises. Les organisations disposent d’une faible visibilité pour se projeter, investir, anticiper. En outre, si le travail était autrefois synonyme de réussite et d’ascension sociale, il n’est plus aujourd’hui qu’un moyen parmi d’autres d’atteindre un idéal de vie plus équilibré et personnel. Les jeunes générations redéfinissent les valeurs de la réussite. Réussir sa vie ne passe plus par un titre, une fonction, un salaire conséquent. Ce bouleversement des valeurs, en particulier chez la « Gen Z », contribue à une plus grande volatilité du travail.
Cette complexité se traduit par une précarité accrue : instabilité des postes, emplois atypiques et flexibilité du travail sont monnaie courante. La stabilité, les trajectoires prédéfinies, les parcours professionnels linéaires n’existent plus. Faire face à l’incertitude est la principale source de stress aujourd’hui.
D'ailleurs, une étude longitudinale menée sur des habitants salariés à Dresde lors du processus de réunification de l'Allemagne, a montré que l’incertitude était la source de stress la plus consistante et la plus forte, avec des coefficients de stabilité toujours proches de 0,90.
Pourtant, le cerveau n’aime pas l’incertitude
Notre cerveau est une machine très performante, mais programmée pour la survie et la recherche de repères stables. Aussi, tout signe d'incertitude est perçu comme une menace. Lorsque nous sommes confrontés à l'inconnu, certaines zones cérébrales s’activent en mode hypervigilance :
• l'amygdale, centre des émotions, s'active et déclenche des réactions de peur ou d'évitement
• le cortex préfrontal s’active pour trouver des stratégies afin de réduire l'incertitude.
Si le sentiment d’incertitude dure dans le temps, il entraîne une cascade de substances (cortisol et noradrénaline), activant notre système de combat ou de fuite. Le cerveau passe en mode défensif, entraînant désengagement, méfiance et réduction de la prise de risque. Les conséquences sont mesurables et délétères en entreprise. Cela peut engendrer des troubles de la mémoire et de la concentration, de l’anxiété, et même des répercussions physiques comme l'hypertension ou l'obésité.
Mieux vaut une bonne certitude erronée, qu’un vrai doute
Nous avons une aversion pour l’incertitude. C’est d’ailleurs l’un des nombreux biais cognitifs qui altèrent notre raisonnement. Car le cerveau est "écologique" : il cherche à réduire l’effort et utilise des raccourcis de pensée pour éviter la complexité. C’est son fonctionnement en mode automatique, soit 95 % du temps. Ces réflexes, bien qu'utiles pour la survie, peuvent être trompeurs et faussement logiques.
Ainsi, face à l'incertitude de notre environnement, les individus et les organisations se tournent vers un "marché des certitudes", cherchant désespérément de nouvelles références extérieures, ce qui confère une sécurité illusoire.
À travers ces biais cognitifs, le cerveau va recréer de façon détournée, une « vérité alternative » qui masque temporairement la complexité :
• Le biais de confirmation : ne retenir que les informations qui collent à nos opinions préexistantes.
• Le biais d’escalade à l’engagement : avoir du mal à reconnaitre son erreur lorsqu’on est engagé massivement sur un projet
• L’illusion de confiance ou d’invulnérabilité : surestimer nos capacités et minimiser le risque
Chercher la stabilité en soi (selon les neurosciences et la philosophie)
Pourtant, la quête de prédiction parfaite et de sécurité totale est illusoire. L’enjeu pour l'entreprise est de trouver le juste équilibre : réduire l'incertitude chronique tout en acceptant la dose d'imprévisible, source d’opportunités et d'innovation. La clef pour gérer l'incertitude réside dans la flexibilité mentale et l'ancrage interne. Plutôt que de s'accrocher aux certitudes extérieures ou de se soumettre au passé, l'individu doit revenir à sa propre identité et ses ressources singulières.
1. Cultiver l'humilité cognitive : reconnaître l’existence de nos biais cognitifs et être vigilant à notre propre raisonnement
2. Adopter une attitude rationnelle et pragmatique : avancer par essais-erreurs en explorant et en ajustant sa démarche
3. S’engager à la transparence : en période de changement, le simple fait de partager de l’information diminue l'incertitude perçue
4. Favoriser l'autonomie : pouvoir prendre des décisions confère le sentiment d’exercer du contrôle sur son environnement, et accroit la confiance
En intégrant ces principes issus des neurosciences, nous n’éliminons pas l’incertitude – ce qui est impossible – mais nous en faisons un levier pour la transformer en moteur d’innovation et de résilience.
Dans nos cerveaux
La chronique explore les méandres de l'esprit humain à travers le prisme des sciences cognitives et comportementales. Celles-ci nous permettent de comprendre la complexité de nos comportements et des processus cognitifs qui les sous-tendent. Mémoire, fonctionnement psychologique et organisationnel, charge mentale ou charge émotionnelle… la science a son mot à dire.