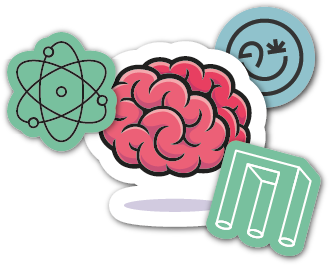Avouons-le : face à une tâche exigeante, il nous est tous déjà arrivé de préférer ranger notre boîte mail ou de scroller “deux minutes” sur un réseau social. Flagrant délit de procrastination ! Pourtant, ce comportement n’est pas un signe de paresse ni de mauvaise gestion du temps. Selon les neurosciences, il reflète une communication altérée entre deux fonctions du cerveau : la régulation émotionnelle pilotée par notre cerveau « archaïque » et la planification gérée par notre cerveau « moderne ». Comprendre ce bug cérébral, c’est retrouver du pouvoir d’agir.
Gérard a du mal à s’y mettre
Sur son bureau, un dossier stratégique l’attend. Gérard sait qu’il est crucial, mais appréhende de s’y mettre. Aussi, pour éviter de confronter la difficulté, il remplit son temps en traitant des courriels sans importance : c’est la procrastination active, cette diversion par des tâches secondaires qui donne l’illusion d’efficacité. En évitant le désagréable, il retarde jusqu’à l’urgence le moment de s’y mettre, entraînant stress et culpabilité. Ce comportement découle de la faible valeur agréable accordée à la tâche, malgré le bénéfice futur.
Une tendance humaine universelle
Repousser au lendemain est une vieille habitude. “Procrastiner” vient du latin pro (vers l’avant) et crastinus (du lendemain). Ce conflit entre raison et impulsion traverse toute l’histoire humaine. Aujourd’hui, la recherche en psychologie, économie comportementale et neurosciences confirme qu’il s’agit d’un biais universel : 20 à 25 % des adultes se disent procrastinateurs chroniques.
Le chercheur Piers Steel a modélisé le phénomène. Selon lui, la procrastination dépend de quatre facteurs : peu de valeur accordée au résultat, une faible confiance en notre capacité à faire, une grande impulsivité et une mauvaise évaluation du délai.
Le cerveau derrière le report
La procrastination est un report volontaire pour éviter l’effort, au profit d’une activité plus gratifiante sur le moment. Elle illustre notre biais du présent : le cerveau surévalue les récompenses immédiates et minimise les bénéfices futurs.
Deux systèmes s’opposent dans une telle situation : le limbique (l’impulsion), centré sur le plaisir immédiat, et le cortex préfrontal (la raison), siège de la planification et du contrôle de soi. Quand le système limbique prend le dessus, la logique cède à l’émotion. Des études montrent que les procrastinateurs ont souvent une amygdale cérébrale plus développée, signe d’une sensibilité émotionnelle accrue.
Ce phénomène est exacerbé par la dopamine, un neurotransmetteur associé à la motivation. Le cerveau est un organe d'anticipation, et la dopamine est libérée par anticipation d'une récompense. Les distractions modernes (réseaux sociaux, jeux) exploitent cette chimie en fournissant des récompenses faciles et immédiates, détournant notre cerveau des projets à long terme qui paraissent beaucoup moins « dopaminergiques » en comparaison.
Comment aider Gérard à se lancer ?
Bonne nouvelle : la procrastination n’est pas une fatalité. Elle se modifie par entraînement du contrôle de soi et reprogrammation du système de récompense.
Réduire la friction, c’est-à-dire la difficulté, avec l’action : éloignez les distractions, bloquez les sites, mettez le téléphone hors de vue.
Fractionner les tâches : chaque micro-avancée libère de la dopamine, moteur de la motivation.
Créer une anticipation positive : visualisez la fierté et les bénéfices lorsque la tâche sera accomplie.
Relier l’effort à vos valeurs : rattachez les actions peu plaisantes à vos objectifs profonds pour leur donner du sens.
Agir malgré l’émotion : la procrastination est souvent un outil de régulation émotionnelle maladroit. Les approches comportementales, comme la règle des 5 minutes, aident à dépasser l’anxiété du démarrage.
La procrastination n’est donc ni un manque de volonté ni un défaut moral, mais une erreur cognitive que l’on peut corriger. En comprenant ses mécanismes cérébraux, Gérard pourra apprendre à réconcilier son cerveau ancien avec ses ambitions modernes.
Dans nos cerveaux
La chronique explore les méandres de l'esprit humain à travers le prisme des sciences cognitives et comportementales. Celles-ci nous permettent de comprendre la complexité de nos comportements et des processus cognitifs qui les sous-tendent. Mémoire, fonctionnement psychologique et organisationnel, charge mentale ou charge émotionnelle… la science a son mot à dire.