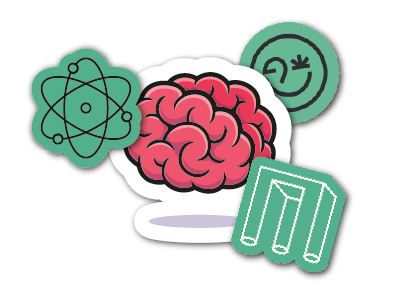Dans nos cerveaux
Les sciences cognitives et comportementales pour comprendre nos décisions
Nous avons tous ce collègue dont le simple tic de langage, la manie d’interrompre ou même le bruit des touches de clavier nous hérisse – parfois sans raison claire. Ces micro-frustrations peuvent sembler anodines, mais elles drainent de l’énergie mentale, nourrissent les tensions et, mal gérées, fragilisent la coopération.
Pourquoi sommes-nous si sensibles aux comportements d’autrui, et pourquoi est-ce souvent disproportionné ? Les neurosciences cognitives et comportementales offrent quelques clés éclairantes.
Notre histoire structure nos stratégies comportementales, et nos intolérances
Notre cerveau, telle une pâte à modeler, se configure progressivement à travers notre histoire. Les événements marquants, notre éducation et les expériences passées structurent nos stratégies comportementales : ce qu’il est bon de faire, ce qu’il vaut mieux éviter. Ce sont nos automatismes mentaux qui enregistrent nos « hot buttons » i.e. nos irritants. Des études montrent d’ailleurs que certains schémas éducatifs peuvent rendre l’esprit rigide et générer une forme d’intolérance aux comportements jugés « inadéquats ». Le mode mental automatique, comme le décrit l’Approche Neurocognitive et Comportementale (ANC) de Jacques Fradin, puise dans ces vécus pour catégoriser de façon réflexe ce qui, selon nous, « ne se fait pas ». Ainsi, un collègue qui parle fort ou arrive en retard peut réveiller nos propres souvenirs négatifs et nous agacer, signe qu’une limite héritée de notre culture familiale a été franchie.
Bien entendu, certaines situations peuvent appeler une réaction légitime de notre part, si les codes de fonctionnement en commun ont été outrepassés.
L’ombre des biais cognitifs
La psychologie cognitive rappelle que notre perception d’autrui est rarement objective. Si un collaborateur nous agace sur un détail (comportement, manie, hygiène…), notre cerveau, par souci d’économie, va généraliser et amplifier ce trait de caractère, biaisant ainsi notre jugement global. Si un autre collaborateur nous coupe la parole une fois, notre mémoire accentuera cette tendance et nous semblera confirmer que « c’est typiquement son style ». C’est le biais de l’effet de halo : un détail frustrant contamine notre jugement global sur une personne.
Difficile tolérance … finalement si courante
Les statistiques illustrent l’ampleur du phénomène : en France, un tiers des salariés déclare être gêné au moins une fois par semaine par l’attitude d’un collègue, et un quart se dit particulièrement agacé par des comportements tels que le bruit, le commérage ou le manque d’hygiène. Par ailleurs, on estime que 22 % des salariés rapportent avoir subi des comportements hostiles au travail, un indice en nette augmentation ces dernières années.
Est-il « comme moi », ou pas ?
La psychologie sociale montre aussi que nous acceptons davantage les écarts chez ceux que nous percevons comme « proches », semblables ou partageant nos valeurs sociales. Alors que nous pouvons être très critiques avec ceux qui transgressent nos normes culturelles. Un accent différent, un rapport au temps moins linéaire, une façon d’interagir jugée « étrange », peuvent activer ce sentiment de méfiance. L’agacement devient alors une forme de réaction à l’altérité, parfois inconsciente mais bien réelle.
Retrouver une marge de manœuvre
Heureusement, la prise de conscience de ces mécanismes est le premier pas vers une régulation émotionnelle adaptée. Solliciter le mode adaptatif du cerveau, comme le propose l’ANC, permet de prendre du recul : se questionner sur l’origine réelle de notre agacement, prendre une intention (« je vais écouter sans jugement »), reformuler positivement et verbaliser avec respect permet d’élargir sa perspective et de diminuer la charge émotionnelle.
La clé réside dans la prise de conscience de nos propres comportements, souvent inconscients, dans l’intelligence collective et la verbalisation responsable des « irritants ». Plutôt que d’incriminer spontanément la personne, mieux vaut traiter l’agacement comme une opportunité de s’ajuster dans le groupe pour mieux travailler ensemble.

Expert sciences & travail
Ce qui l’intéresse, ce n’est pas tant la communication en surface que ce qui se joue en profondeur : les perceptions, les mécanismes cognitifs, les…
Dans nos cerveaux
Au travail comme à la maison, les sciences cognitives et comportementales nous permettent de comprendre de plus en plus finement la complexité de nos comportements et des processus cognitifs qui les sous-tendent. Mémoire, fonctionnement psychologique et organisationnel, charge mentale ou charge émotionnelle : chaque chronique explore les méandres de l'esprit humain à travers le prisme des sciences cognitives et comportementales.