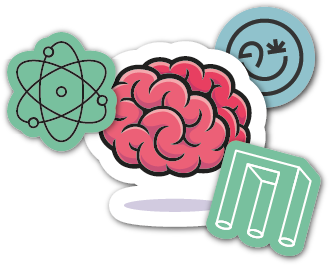Apprendre. Un mot si simple et si fondamental puisqu’il a sûrement permis à l’espèce humaine de survivre jusqu’à aujourd’hui en s’adaptant aux changements. En entreprise, c’est l’une des compétences cruciales pour durer et se développer, aussi bien individuellement que collectivement. On apprend un nouveau logiciel, un métier, un mode de management. Aussi courant que cela puisse être, que signifie « apprendre » du point de vue des sciences du cerveau ?
Ce que révèlent les neurosciences cognitives bouscule bien des idées reçues.
Apprendre, un processus dynamique d’adaptation
L’apprentissage ne consiste pas à emmagasiner passivement de l’information, comme on remplirait une base de données. C’est un processus actif, adaptatif, profondément biologique. Apprendre, c’est transformer durablement son cerveau. Chaque nouveau savoir, chaque compétence acquise, se traduit par la création ou la reconfiguration de connexions neuronales. Apprendre consiste à créer de nouvelles connexions entre des neurones existants, ou à développer de nouveaux neurones. C’est la neuroplasticité : la capacité du cerveau à se modifier à travers l’expérience. Apprendre un nouveau process, intégrer une organisation hybride, ou adopter une posture de feedback, revient – littéralement – à réorganiser son architecture cérébrale.
Les 4 piliers de l’apprentissage selon Stanislas Dehaene
Le neuroscientifique français Stanislas Dehaene a identifié quatre piliers indispensables pour qu’un apprentissage soit efficace : l’attention, l’engagement actif, le retour sur erreur et la consolidation. Or, dans les environnements professionnels, chacun de ces piliers est mis à rude épreuve.
L’attention, en premier lieu, est le sésame d’entrée dans le cerveau. Mais entre “open spaces” bruyants, visioconférences à rallonge et hyper-sollicitations numériques, elle est souvent la première victime. L’engagement actif, ensuite, suppose que l’apprenant soit acteur – qu’il teste, interagisse, expérimente. Ce que confirment les résultats en entreprise : les ateliers pratiques, les mises en situation ou les simulations ancrent beaucoup plus efficacement les savoirs que les formations descendantes. Le troisième pilier, le retour sur erreur, est fondamental : le cerveau apprend en se trompant, à condition d’être informé de ses erreurs de manière constructive. Le feedback, trop souvent vécu comme un jugement, devrait être compris comme un outil de « régulation cognitive » pour identifier sans sentence le décalage entre le vécu et l’attendu. Enfin, la consolidation nécessite du temps, du sommeil, et des rappels espacés. Sans cela, l’information reste éphémère. Les pratiques de microlearning, consistant à fractionner l’apprentissage en capsules courtes et régulières, répondent précisément à ce besoin biologique.
Les études de Dehaene se confirment sur le terrain. Duolingo maintient plus de 500 millions d’utilisateurs actifs en personnalisant les leçons aux performances cognitives des apprenants. Et l’organisme de formation Cegos, en adaptant ses modules aux découvertes en neurosciences, a vu la satisfaction des collaborateurs grimper et les performances d’apprentissage augmenter.
Quand apprendre est une charge
Pourtant, l’apprentissage a des limites. John Sweller, psychologue australien, les a identifiées avec sa théorie de la charge cognitive. Elle rappelle que notre mémoire de travail, avec laquelle nous manipulons des données dans l’instant, est très limitée (4 à 7 éléments à la fois, selon Cowan, 2010). Si on surcharge l’apprenant d’informations mal organisées, il n’apprend pas. Sweller distingue trois types de charges : intrinsèque (liée à la complexité du contenu), extrinsèque (liée à la manière de le présenter) et essentielle (réellement utile à l’apprentissage). Autrement dit, trop de slides, trop de mots, trop vite, c’est l’échec assuré ! D’où l’importance de contrebalancer l’effort pour apprendre par le plaisir du jeu (gamification) ou la motivation du sens.
Déconstruire pour reconstruire
Enfin, apprendre passe aussi par le fait de désapprendre. L’une des grandes résistances au changement vient de nos apprentissages passés, devenus automatiques. C’est ce qu’on appelle l’interférence proactive : un comportement appris empêche un nouveau de s’installer. Pour y remédier, il faut créer un espace de sécurité psychologique (Amy Edmondson, 1999) où les collaborateurs peuvent tester, se tromper, interroger leurs automatismes sans se sentir jugés.
Apprendre pour survivre dans un monde qui évolue vite
Apprendre n’est donc pas une affaire d’empilage de savoirs, mais plutôt un processus de transformation. Ce processus requiert du temps, des ajustements, du feedback, de l’action et des conditions favorables. Dans un monde où les compétences se périment aussi vite que les technologies évoluent, comprendre comment le cerveau apprend n’est plus une option, mais un levier stratégique. C’est en respectant son fonctionnement que l’on peut réellement mettre en place une culture de l’apprentissage continu.
Dans nos cerveaux
La chronique explore les méandres de l'esprit humain à travers le prisme des sciences cognitives et comportementales. Celles-ci nous permettent de comprendre la complexité de nos comportements et des processus cognitifs qui les sous-tendent. Mémoire, fonctionnement psychologique et organisationnel, charge mentale ou charge émotionnelle… la science a son mot à dire.